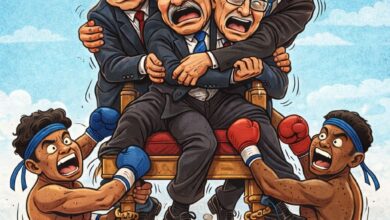Bouydounane : une allégorie sociale – Par Mimoun Ambsrid
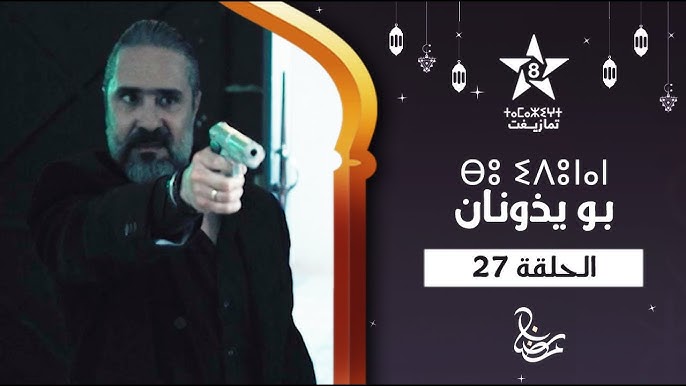

Par mimoun amsbrid
Avec Bouydounane, sa dernière série diffusée sur Tamazight TV, Mohamed Bouzaggou s’impose une fois encore comme un maître de la narration allégorique. À travers des intrigues complexes et un univers dramatique d’une rare densité, il scrute les pathologies sociales du Maroc contemporain — corruption, crise des valeurs, déracinement culturel — en les transposant dans des fictions aux ressorts profonds. Alliant critique sociale, exigence esthétique et engagement amazigh, Bouzaggou signe une œuvre qui interroge autant qu’elle captive. Mimoun Amsbrid revient sur une série portée par une mise en scène de Tariq al Idrissi et un casting intergénérationnel habité.
Mohamed Bouzaggou, un faiseur d’allégories
Série après série, M. Bouzaggou s’affirme en tant que spécialiste ès construction d’allégories sociales. Le scénariste se saisie de phénomènes sociétaux (corruption, cupidité, inégalité de genres, despotisme…) pour les métamorphoser en fictions à dimensions allégoriques. Fictions où critique sociale et création de plaisir esthétique vont de pair.
Dans sa dernière série de trente épisodes, intitulée Bouydounane, (diffusée par la 8), il donne libre cours à son talent de constructeur d’objets sémantiques d’une complexité démoniaque. Cette complexité ne concerne pas que la structure de l’ouvrage, composé d’intrigues tous azimuts qui versent dans l’intrigue-mère. La complexité formelle se veut matérialisation de la complexité de la condition humaine au sein d’une société travaillée par ses contradictions. Le Mal a sa traduction dans les maux qui gangrènent le corps social. Les individus, eux, en sont les supports, les vecteurs (et souvent les victimes). Les carences dues aux manquements de l’Etat en matière de développement fournissent un terreau fertile à la traite des êtres humains(mafias de l’émigration clandestine); l’absence de sécurité sociale et son corollaire l’impuissance devant la maladie d’une mère pousse le fils, pourtant idéaliste, à la compromission en vendant son âme à un corrupteur dans l’espoir de sauver sa mère d’une mort imminente; la crise des valeurs, provoquée par l’irruption brusque du modèle consumériste dans une société qui n’en a pas les conditions économiques qui satisfassent légalement les envies de consommation effrénée chez les individus engagés dans cette voie, pousse ces derniers à faire dans les magouilles afin d’assouvir lesdits envies ; la perte de l’identité culturelle, source de sens, projette les personnes dans un pragmatisme synonyme de cynisme …
Au premier sens de l’intrigue
Mais attention ! Il n’est pas question, dans cette série, d’une énième représentation de l’éternel combat entre le Bien et le Mal. Pas de place pour le manichéisme chez Bouzaggou. Aussi, même les personnages les plus engagés dans la lutte contre le Mal tel qu’il se manifeste via les maux sociaux sont traversés par le doute… J’ai parlé d’intrigues tous azimuts : le mot “intrigue” retrouve ici son sens premier selon le Robert : “Ensemble de combinaisons secrètes et compliquées.” Dans cette série tout le monde intrigue contre tout le monde. D’où le suspens généralisé. À chacun sa vérité qui échappe aux autres et souvent à lui-même. La Corruption est représentée sous forme d’instance à identités multiples, dont l’effet ruisselle sur tous les personnages à des degrés divers.
Le suspens n’est donc pas qu’un ressort dramatique dont le but est de maintenir la curiosité du spectateur. Il découle, au contraire, du champ des possibles dans une configuration de relations que seuls les intérêts contradictoires des uns et des autres déterminent. Les uns en tant que meneurs de jeu, les autres en tant qu’adjuvants ou opposants, agents ou patients…
Bouzaggou est un habitué de ces constructions allégoriques fondées sur des entités archétypales (WAF dans la pièce de théâtre qui porte le même nom ; Maghridou dans une précédente série…). Leur fonction est double : syntaxique ou compositionnelle (elles assurent la cohésion de l’ensemble) et sémantique (elles sont à l’origine des enjeux autour desquels s’articulent les actions des personnages, qu’elles soient pour ou contre.
Un mot sur la langue du dialogue
Le lexique utilisé est contaminé par les langues de contact que sont l’arabe et l’espagnol. Ce choix semble répondre au principe de réalisme linguistique. Aussi, les emprunts pratiqués dans le langage courant n’ont pas été éludés ; les innovations lexicales ne sont convoquées que d’une façon parcimonieuse. Cela étant dit, la thématique amazighe est bien présente dans la série. Il y est fait allusion de diverses manières : évocations d’auteurs d’expression amazighe ; usage symbolique de tifinaghes…
Une mise en scène bluffante
L’allégorie sociale qu’est la série Bouydounan est servi par une mise en scène d’une efficience extraordinaire, œuvre d’un Tariq al Idrissi passé maître dans son art. Maîtrise absolue du timing ; ingéniosité dans la distribution des scènes ; virtuosité dans la production d’effets de suspens ; rare savoir-faire dans l’aménagement des situations génératives de surprises ; usage réussi du langage corporel des acteurs ; sémiotisation de l’espace…
Des acteurs à la hauteur de la mission
Le scénario est pris en charge au niveau de l’interprétation par une équipe d’acteurs convaincus et convaincants. Leur jeu donne l’impression qu’ils sont en mission : non seulement celle d’interpréter leurs rôles réciproques avec le plus d’implication et de naturel, mais aussi celle de participer à un projet qui les englobe et les dépasse : celui d’œuvrer à la consolidation d’une culture de l’image dont nous étions, en tant qu’amazighones, exclus. L’aisance des anciens (les Aznabet, les Zanoun, les Mestiri, Noumidia) ; le professionnalisme de la génération intermédiaire (M. Soultana, N. Belgharbi, M. al Meknouzi, R. Amaatoug, Omar el Hemmouti, A. Zouagi, A. Abdellah, T. Chami, M. Bensaid, T. Mâach, A. Rochdi) ; la sincérité et la générosité de la génération montante (Chaymaa Boutahri, Nadia Saidi, Adnan Rachdi) sont autant de facteurs qui ont contribué à faire la réussite de la série.(Que celles et ceux dont je n’ai pas cité le nom ou classé dans une catégorie non adaptée me pardonnent). Comme dans les séries précédentes de M. Bouzaggou et celle des frères Abernous notamment, il s’agit de vraies écoles d’interprétation où de nouvelles recrues viennent se frotter aux savoir-faire des acteurs aguerris. Ce faisant, elles pallient l’absence d’instituts d’art dramatiques dans l’ensemble du Rif.
Pour un décloisonnement de la chaîne Tamazighte
La qualité des œuvres de fiction telles que Bouydounan, entre autres, devrait inciterles responsables de l’audiovisuel à les sortir du ghetto de l’amazighité qu’est la chaîne Tamazighte pour étendre leur audience, via le sous-titrage et/ou le doublage, à l’ensemble des Marocains. C’est en l’ouvrant sur toutes ses expressions qu’on sera à même de renforcer le tissu culturel marocain ; tâche ô combien urgente par ces temps d’égarement.